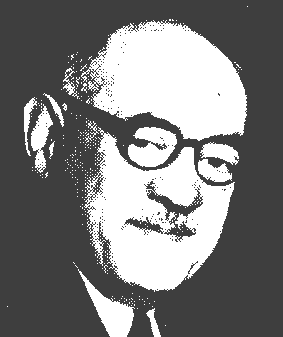
|
|
« La langue grecque est difficile. La plupart de nos écoliers entendent peu de chose à son mécanisme subtil. Il arrive aussi que ceux qui se débrouillent ne sont pas les plus sensibles aux beautés poétiques que cette clé devrait leur révéler... Cependant -- "miracle grec" cette fois -- les classes de notre collège sont combles d'hellénistes. Parmi lesquels, sans doute, beaucoup d'élèves gentils et dociles, prêts à retenir et à oublier une masse de choses dont ils n'auront jamais rien fait. Qu'on lâche donc ces enfants dans les vertes prairies de l'anglais ! Elles sont belles, me dit-on, les fleurs de la culture anglaise... Socrate ne dédaignait pas l'utile. Il le confondait avec le beau. Je l'entends presque dire à ses disciples: "Il y aurait bien le proto-minoen... Mais apprenez donc le persan". Pour moi, je redoute le snobisme du grec. Si la responsabilité dont je suis chargé m'y autorise, je voudrais déclarer que le grec constitue la plus aristocratique des cultures, accessible à ceux-là seuls qui sont capables du plus grand effort et doués du plus grand amour. Dès lors: génératrice de vertu.
« Croyez, Mesdames et Messieurs, que je n'aurais pas tenu ce langage, si vingt-trois ans d'une double intimité, celle des poètes grecs et celle de la jeunesse que j'enseigne, ne m'avaient apporté, à côté de l'expérience que j'ai dite, des témoignages certains de la valeur formatrice de l'humanisme grec.
« Toute la grande poésie grecque, attachant à la connaissance de la vie sa passion de la vérité, rejetant l'illusion d'un ordre providentiel de l'univers dont l'homme serait le bénéficiaire, non moins fermement que le mythe de la bonté de la nature humaine, écartant le refuge des au-delà consolateurs et des religions de salut, offre à l'homme, dans ce cercle dur d'un univers qui ne le reçoit pas, le miroir de sa tragique solitude.
« Pourtant il est l'homme. Il est celui qui pense et assume le tragique de l'existence. Modeste et droit, s'il crée la tragédie, ce n'est pas pour grandir complaisamment sa stature et s'abuser sur son pouvoir, c'est pour se contempler, faible et nu, à l'échelle des dieux et, constatant l'inhumanité du monde, y répondre par un acte de confiance en son humanité. En face d'un Ordre insaisissable, qui ne se révèle à lui que dans ses "déviations arbitraires", l'homme installe son ordre propre, qui est noblesse. Cerné par l'amoralisme du monde, il se fabrique l'outil de sa morale -- chef-d'oeuvre de sa faculté de juger -- qu'il insère comme une pointe aiguë dans les pièges de l'univers. La mort ne le fait plus trembler, dès l'instant où il s'en fait l'occasion d'un choix ente l'honneur et la honte.
« Nombreux, dans la poésie grecque, est le peuple des hommes et des femmes que la présence de la mort oblige à se connaître dans l'épreuve d'un choix, à s'affirmer dans un acte de fidélité à la justice ou à l'amour -- à poser l'exigence de la noblesse humaine.
« Telle est la simplicité de l'humanisme antique, telle est sa violence. Assez simple pour toucher un enfant. Trop violent pour sa jeune chair, si, dans la chair de l'enfant, il n'y avait l'homme qui demande à naître. »
André Bonnard : J'ai pris l'humanisme au sérieux (Lausanne, L'Aire, 1991), pp. 37, 39-40 (discours prononcé en 1938, à l'occasion de son installation comme professeur ordinaire de langue et littérature grecques à l'Université de Lausanne).
[Début]
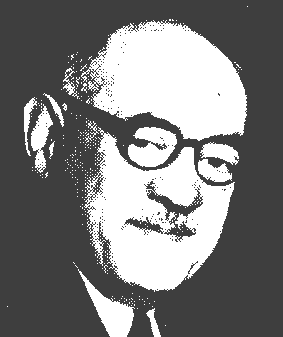
|
|
Le 16 août 1888, André BONNARD, bourgeois de Nyon, naît à Lausanne. Il poursuit des études secondaires et supérieures à Lausanne et à Paris. Puis il enseigne dans divers collèges ; dès 1923 au Collège classique cantonal (Béthusy aujourd'hui), puis au Gymnase classique de Lausanne (actuel Gymnase de la Cité). En 1928, il devient titulaire de la chaire de grec à l'université de Lausanne. La même année, il publie « Le Prométhée » d'Eschyle. En 1938, des étudiants créent sa version de l'« Antigone » de Sophocle. En 1942, publication d' « Iphigénie à Aulis ». Deux ans plus tard, Mermod fait paraître « Les dieux de la Grèce » et l'année suivante « Socrate selon Platon ». En 1946, André BONNARD donne sa version d'« Oedipe-Roi » de Sophocle. En 1948 paraît « Alceste » d'Euripide, aux Éditions du Griffon, à Neuchâtel, cependant qu'à Lausanne paraît, chez Mermod, « La poésie de Sapho ». En 1949, André Bonnard est élu président du Mouvement suisse de la paix et l'année suivante, membre du Conseil mondial de la paix. Cette même année, il publie « La tragédie et l'homme », à La Baconnière. En 1952, cependant que paraissait sa version d' « Agamemnon » d'Eschyle, il était inculpé d'espionnage au profit de l'URSS en vertu de l'article 272 du Code pénal suisse. En 1954, André Bonnard reçoit le Prix Staline pour la Paix. Il publie le premier tome de « Civilisation grecque ». Le 29 mars, début de son procès ; le 2 avril, il est condamné « à 15 jours d'emprisonnement avec sursis ». En 1957 paraît le deuxième tome de « Civilisation grecque » ; la même année, il prend sa retraite. Le troisième tome de « Civilisation grecque » paraît quelques jours avant sa mort, survenue le 18 octobre 1959. Aujourd'hui,
une petite place porte son nom au nord de l'Ancienne Académie (actuel
gymnase de la Cité), où se trouvait la faculté des Lettres du temps où
Bonnard y enseignait. Voir
Yves Gerhard, André Bonnard et l'hellénisme à
Lausanne au XXe siècle;
Vevey, Ed. de l'Aire, 2011.
|
[Début]

André
GIDE
Gide , L'immoraliste
« Fais ton bonheur d'augmenter
celui de tous.
Travaille et lutte et n'accepte de mal rien de ce que tu pourrais
changer. Sache te répéter sans cesse : il ne tient
qu'à moi. On ne prend point son parti sans
lâcheté de tout le mal qui dépend des hommes.
Cesse de croire, si tu l'as jamais cru, que la sagesse est dans la
résignation; ou cesse de prétendre à la
sagesse.
Camarade, n'accepte pas la vie telle que te la promettent les hommes.
Ne cesse point de te persuader qu'elle pourrait être plus
belle, la vie; la tienne et celle des autres hommes; non point une
autre, une future, qui nous consolerait de celle-ci et qui nous
aiderait à accepter sa misère. N'accepte pas. Du jour
où tu commenceras à comprendre que le responsable de
presque tous les maux de la vie, ce n'est pas Dieu, ce sont les
hommes, tu ne prendras plus ton parti de ces maux.
Ne sacrifie pas aux idoles »
Gide, Les nourritures terrestres, dernière page (cf. Prométhée dans le Protagoras, et dans Antigone)
(Préface à l'édition de 1927)
[Début]

André Malraux
«
…ce que recouvre pour nous le mot si confus de culture – l'ensemble
des créations de l'art et de l'esprit – c'est à la Grèce que revient la
gloire
d'en avoir fait un moyen majeur de la formation de l'homme. C'est par
la première
civilisation sans livre sacré, que le mot intelligence a voulu dire
interrogation. L'interrogation dont allait naître la conquête du cosmos
par la
pensée, du destin par la tragédie, du divin par l'art et par l'homme. »
[Début]

Prière pour l'Acropole
Le
26 janvier 1945, en ouverture de l'Iphigénie à
Aulis dans
l'adaptation d'André Bonnard,
lecture
fut donnée du texte suivant du poète vaudois Paul Budry (voir Desmos,
bulletin de l'Association
des amitiés gréco-suisses, no. 29, 2000, p. 15-18), qui montre
à quel point Paul Budry vénérait la Grèce antique,
qui l'inspirait comme un modèle, un exemple parfait à
imiter.
« Vingt siècles ont passé, Pallas, depuis que s'est éteinte au-dessus de ton temple la mèche dorée de ta lance, que les marins saluaient du large, après leurs errements nocturnes, comme une étoile née du jour pour les ramener aux délices du port. Éteinte pour les yeux, elle brille encore dans notre esprit, ramenant chaque jour nos pensées vers Athènes. Vingt siècles ont passé depuis que les panathénéennes aux robes cannelées, ces colonnes en marche, franchissait ton portique de marbre pour t'apporter dans les plis du péplum propitiatoire les grâces et les prières de la cité, tandis que les éphèbes pressant entre leurs cuisses leurs poulains à la crinière en brosse remplissaient ton parvis d'un tumulte viril. Et nous t'apportons toujours notre culte. Depuis lors, combien de barbares sont venus, du nord et du sud, de l'est et de l'ouest, les uns avec la croix, les autres le croissant, ceux-ci avec le glaive, ceux-là avec des boulets, avec leurs fureurs, leur stupidité et leurs dogmes, les uns ivres de détruire, les autres d'emporter. Ils t'ont ravi, Pallas, tes ors, tes ivoires et tes marbres. Jusqu'aux dieux, assis jadis dans ton fronton, qu'ils ont exilés dans les salles brumeuses d'un musée britannique, où les hôtes de l'empyrée se consument sous un éclairage de réverbères de gare. Ils ont écorché, descellé, renversé et moulu tes pierres, mais ils n'ont pu faire que ces ruines, et chaque débris de ces ruines, ne proclament encore ton intelligence souveraine.
« Inventeuse de l'olivier, ton temple est éventré et creux comme ces oliviers millénaires qu'om rencontre aux collines du Garrian, n'ayant plus que l'écorce, mais d'où s'épanouit encore une couronne de feuilles et de fruits. Sur tes ruines continue de mûrir à jamais l'huile mystique des onctions et des sacres. Levées sur l'Acropole comme un lécythe brisé, les pierres distillent à jamais la liqueur de l'esprit qui dispose les hommes à accueillir les dieux.
« A cette heure les avions rasent tes architraves, portant sous le ventre des chargements de mort, dont un seul en tombant sur tes marbres fragiles les réduirait en poudre. Faudra-t-il perdre encore cela ? Faut-il peut-être ce sacrifice unique, comme il fallut jadis celui d'Iphigénie, pour gagner les faveurs des dieux ? Mais cette guerre n'est plus la guerre des hommes contre les hommes, c'est la guerre des dieux mêmes, dieux du Nord contre dieux du Midi, c'est le ténébreux Walhalla à l'assaut de l'Olympe radieux. Et l'enjeu, ô toute-sage, toute-sereine, toute-bonne, Pallas, dont l'haleine immortelle respire encore sur la roche sacrée, l'enjeu, Raison, c'est toi.
« À l'heure où la fortune des armes commence de sourire aux tiens, ne reviendras-tu point, Pallas, étendre ton palladium sur la colline, afin qu'un aviateur distrait ou qu'un pointeur ivre n'aillent pas, grands dieux, jeter par terre tes portiques et priver le monde à jamais du suprême refuge de la Beauté ? »
[Début]

Prière sur l'Acropole
« Ô noblesse ! ô beauté simple et vraie ! déesse dont le culte signifie raison et sagesse, toi dont le temple est une leçon éternelle de conscience et de sincérité, j'arrive tard au seuil de tes mystères ; j'apporte à ton autel beaucoup de remords. Pour te trouver, il m'a fallu des recherches infinies. L'initiation que tu conférais à l'Athénien naissant par un sourire, je l'ai conquise à force de réflexions, au prix de longs efforts.
« Je suis né, déesse aux yeux bleus, de parents barbares, chez les Cimmériens bons et vertueux qui habitent au bord d'une mer sombre, hérissée de rochers, toujours battue par les orages. On y connaît à peine le soleil ; les fleurs sont les mousses marines, les algues et les coquillages coloriés qu'on trouve au fond des baies solitaires. Les nuages y paraissent sans couleur, et la joie même y est un peu triste ; mais des fontaines d'eau froide y sortent du rocher, et les yeux des jeunes filles y sont comme ces vertes fontaines où, sur des fonds d'herbes ondulées, se mire le ciel.
« Mes pères, aussi loin que nous pouvons remonter, étaient voués aux navigations lointaines, dans les mers que tes Argonautes ne connurent pas. J'entendis, quand j'étais jeune, les chansons des voyages polaires ; je fus bercé au souvenir des glaces flottantes, des mers brumeuses semblables à du lait, des îles peuplées d'oiseaux qui chantent à leurs heures et qui, prenant leur volée tous ensemble, obscurcissent le ciel.
« Des prêtres d'un culte étranger, venu des Syriens de Palestine, prirent soin de m'élever. Ces prêtres étaient sages et saints. Ils m'apprirent les longues histoires de Cronos, qui a créé le monde, et de son fils, qui a, dit-on, accompli un voyage sur la terre. Leurs temples sont trois fois hauts comme le tien, ô Eurhythmie, et semblables à des forêts ; seulement ils ne sont pas solides ; ils tombent en ruine au bout de cinq ou six cents ans ; ce sont des fantaisies de barbares, qui s'imaginent qu'on peut faire quelque chose de bien en dehors des règles que tu as tracées à tes inspirés, ô Raison. Mais ces temples me plaisaient ; je n'avais pas étudié ton art divin ; j'y trouvais Dieu. On y chantait des cantiques dont je me souviens encore : « Salut, étoile de la mer … reine de ceux qui gémissent en cette vallée de larmes » ; ou bien : « Rose mystique, Tour d'ivoire, Maison d'or, Étoile du matin… » Tiens, déesse, quand je me rappelle ces chants, mon cœur se fond, je deviens presque apostat. Pardonne-moi ce ridicule ; tu ne peux te figurer le charme que les magiciens barbares ont mis dans ces vers, et combien il m'en coûte de suivre la raison toute nue. »
Renan, Souvenirs d'enfance et de jeunesse.
[Début]

Visite à l'Acropole
« J'ai vu, du haut de l'Acropolis, le soleil se lever entre les deux cimes du mont Hymette ; les corneilles, qui nichent autour de la citadelle mais qui ne franchissent jamais son sommet, planaient au-dessous de nous ; leurs ailes noires et lustrées étaient glacées de rose par les premiers reflets du jour ; des colonnes de fumée bleue et légère montaient dans l'ombre le long des flancs de l'Hymette et annonçaient les parcs ou les chalets des abeilles ; Athènes, l'Acropolis et les débris du Parthénon se coloraient de la plus belle teinte de la fleur du pêcher ; les sculptures de Phidias, frappées horizontalement d'un rayon d'or, s'animaient et semblaient se mouvoir sur le marbre par la mobilité des ombres du relief ; au loin, la mer et le Pirée étaient tout blancs de lumière ; et la citadelle de Corinthe, renvoyant l'éclat du jour nouveau, brillait sur l'horizon du couchant comme un rocher de pourpre et de feu.
« Du lieu où nous étions placés, nous aurions pu voir, dans les beaux jours d'Athènes, les flottes sortir du Pirée pour combattre l'ennemi ou pour se rendre aux fêtes de Délos ; nous aurions pu entendre éclater au théâtre de Bacchus les douleurs d'Œdipe, de Philoctète et d'Hécube ; nous aurions pu ouïr les applaudissements des citoyens aux discours de Démosthène. Mais hélas ! aucun son ne frappait notre oreille. À peine quelques cris échappés à une populace esclave sortaient par intervalles de ces murs qui retentirent si longtemps de la voix d'un peuple libre. Je me disais, pour me consoler, ce qu'il faut se dire sans cesse : Tout passe, tout finit dans ce monde. Où sont allés les génies divins qui élevèrent le temple sur les débris duquel j'étais assis ? Ce soleil qui peut-être éclairait les derniers soupirs de la pauvre fille de Mégare, avait vu mourir la brillante Aspasie. Ce tableau de l'Attique, ce spectacle que je contemplais, avait été contemplé par des yeux fermés depuis deux mille ans. »
Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem.
